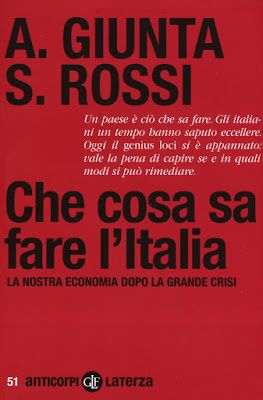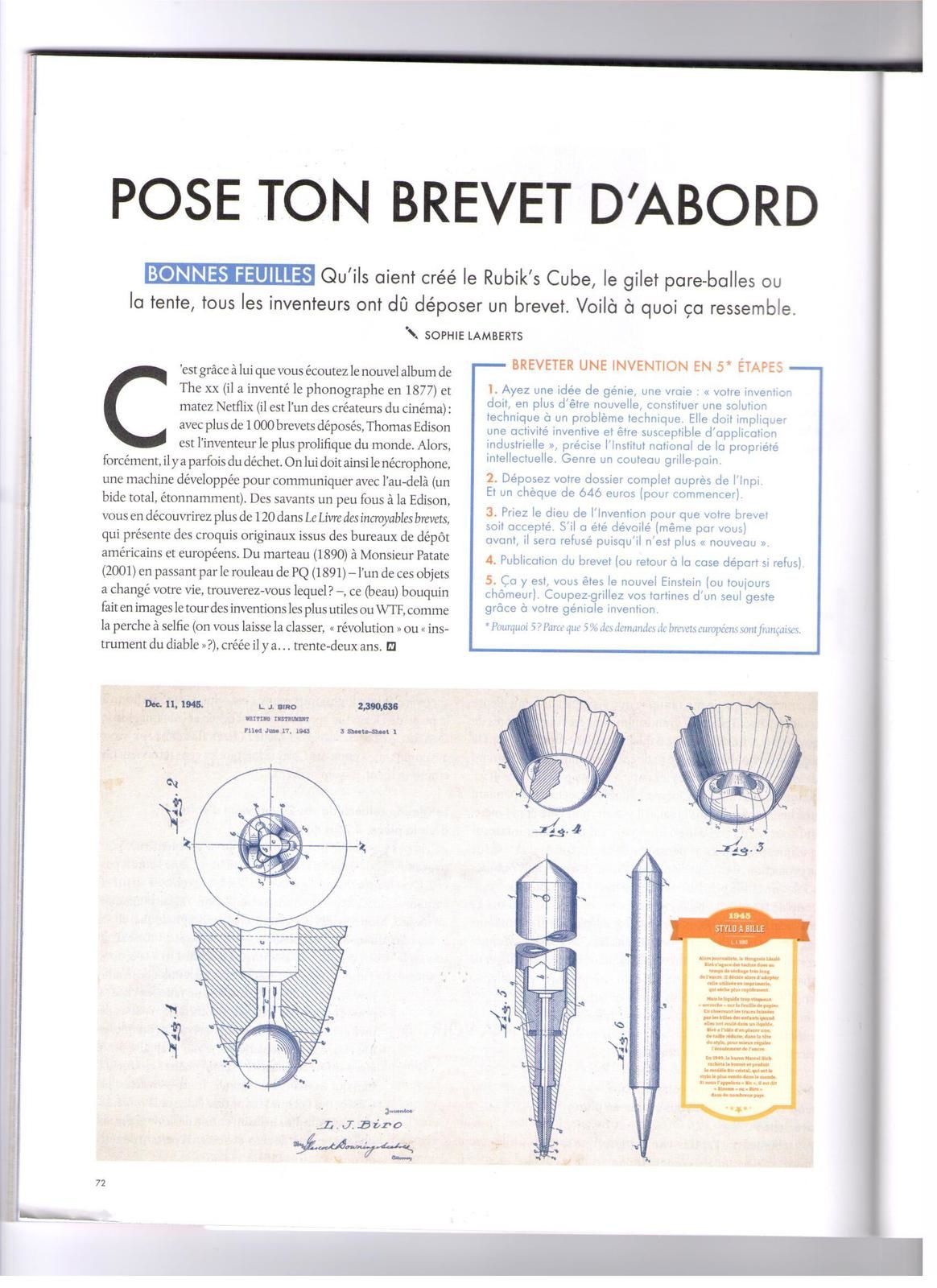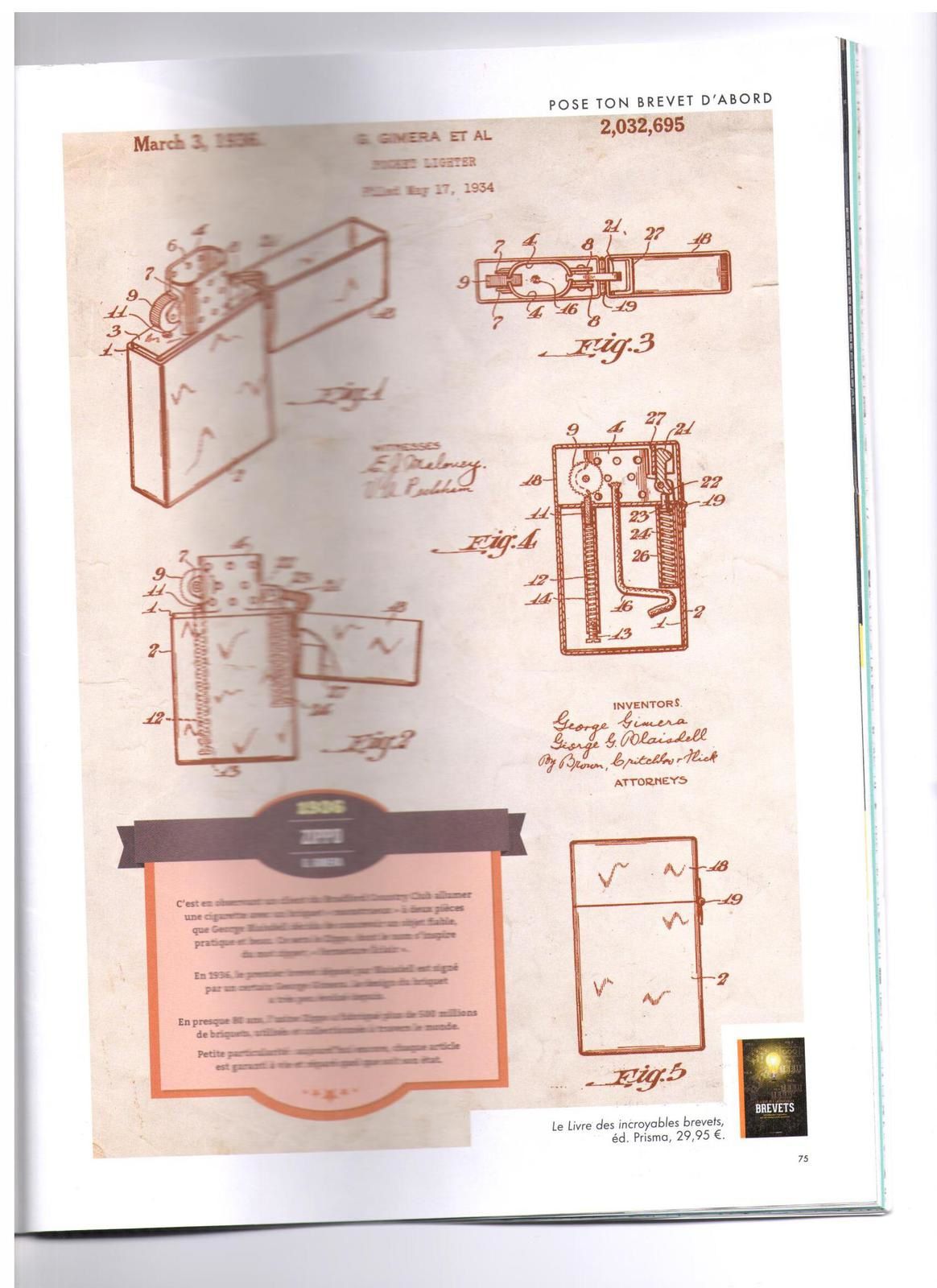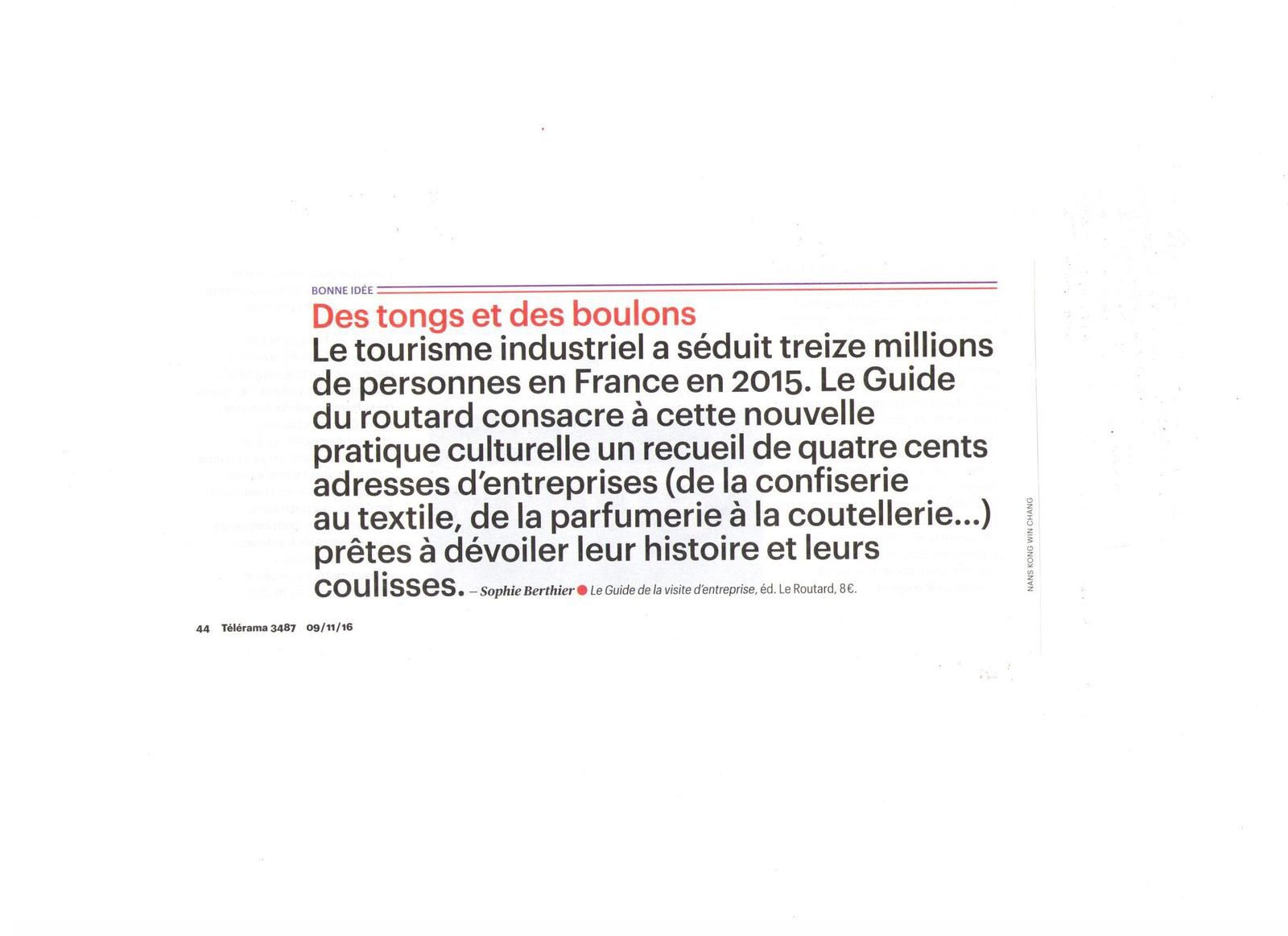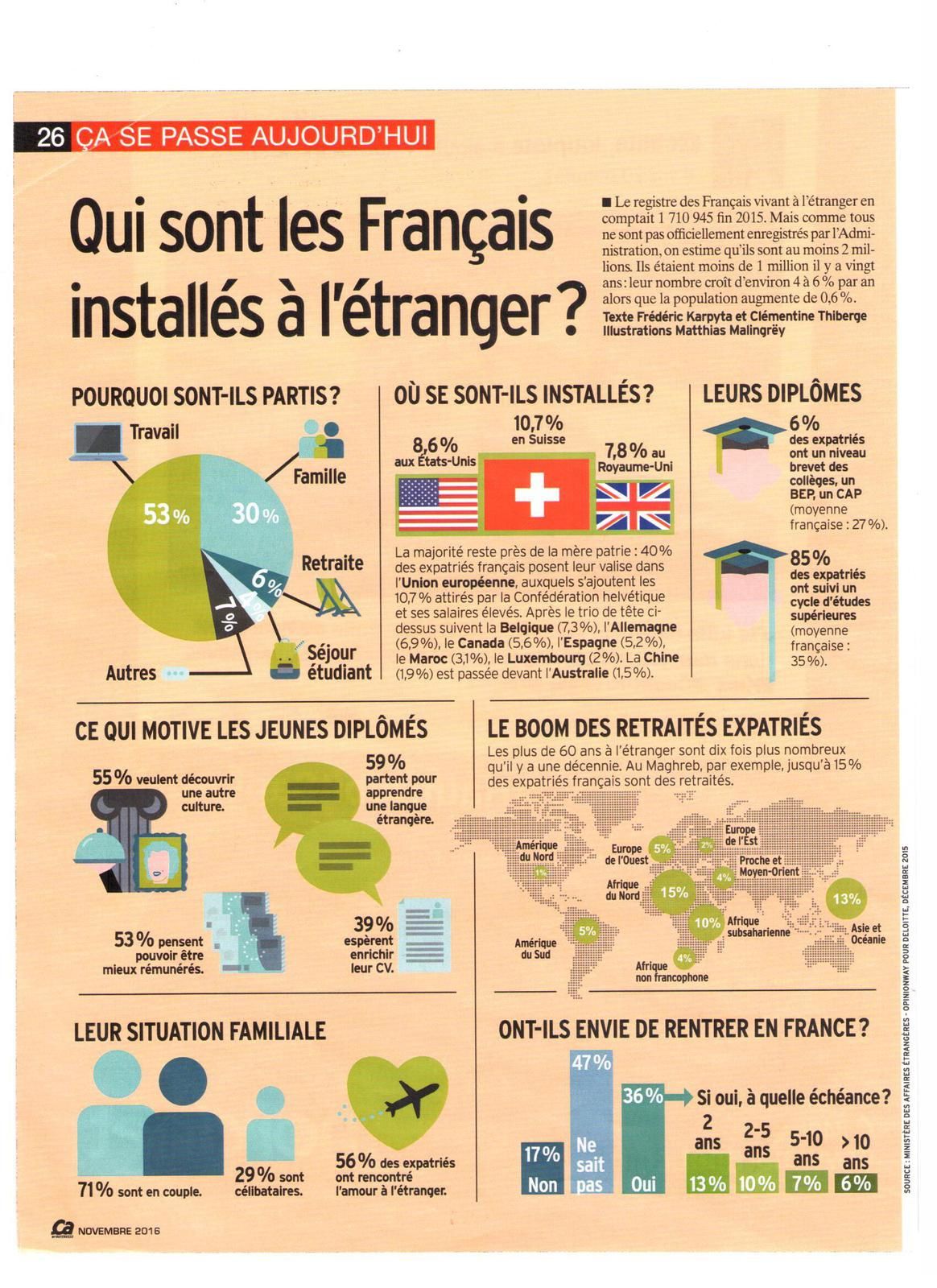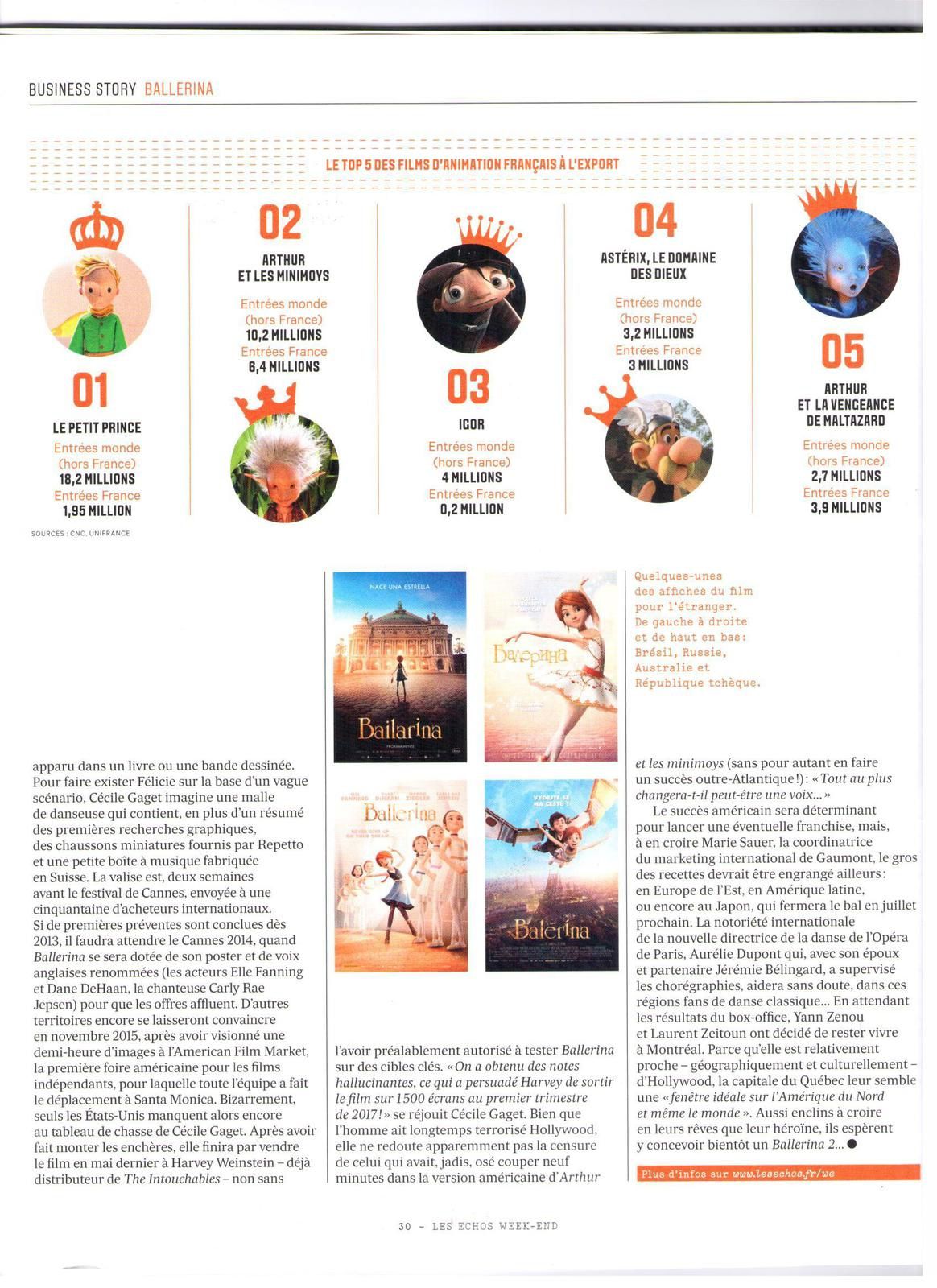Allemagne, Italie (suite)
. Pour plus d'informations, n'hésitez-pas à lire ou à relire le dossier du 24 novembre 2014, intitulé : Allemagne, un autre modèle à suivre ?
Pas une semaine ne se passe sans que la presse italienne ne se fasse l'écho d'un projet français visant l'une de ses entreprises: l'Hexagone est devenu un spectre, contre lequel certains commencent à brandir l'étendard de l'"italianité".
"Il y a un projet pour amener UniCredit en France (...), prendre le contrôle de Generali et un morceau important de Mediobanca", la principale banque d'affaires italienne, affirmait le 11 janvier le président de la commission budgétaire de la Chambre des députés, Francesco Boccia.
"Nous sommes en train de perdre des morceaux importants du système financier et économique italien", ajoutait-il, en proposant une enquête sur l'avenir du capitalisme dans la péninsule.
Régulièrement, la presse italienne égrène la liste des entreprises passées sous giron français, du luxe à la banque, en passant par l'agroalimentaire: Gucci, Loro Piana, Pioneer Investments, Parmalat... Pour beaucoup des entreprises considérées comme des fleurons du Made in Italy.
La fusion du fabricant de lunettes Luxottica avec le français Essilor a de nouveau plongé le pays dans le doute --le siège du futur géant étant situé en banlieue parisienne.
A tel point que son patron, Leonardo Del Vecchio, a dû se fendre lundi d'une note pour rassurer ses troupes: sa holding sera "à long terme l'actionnaire principal du nouveau groupe et si lui-même venait à se retirer avant trois ans, des clauses contractuelles prévoient que son poste de PDG "revienne à un homme de Luxottica".
La montée éclair en décembre du français Vivendi au capital du groupe de médias Mediaset, dont il détient désormais près de 30%, semble avoir créé un traumatisme.
Même le gouvernement de centre-gauche est monté au créneau pour critiquer la façon "non appropriée" dont s'était déroulée la manœuvre, apportant un soutien inattendu à Silvio Berlusconi (droite).
"Les Français sont plus forts dans la défense et dans l'attaque. Ils sont plus organisés", déplorait mardi le président de Mediaset, Fedele Confalonieri, en "remerciant le Parlement, le gouvernement, les journalistes et l'opinion publique qui nous ont défendus".
A la suite de l'"escalade hostile" de Vivendi, qui s'était déjà emparé en 2015 de près du quart de Telecom Italia, le gouvernement a indiqué réfléchir à augmenter les obligations de transparence pour les acquéreurs.
"Rôle stratégique"
Silvio Berlusconi a lui appelé à la mobilisation des "comités pour la défense de l'italianité de Mediaset", expression qui a interrogé jusque dans la presse. Il s'agit en fait des actionnaires historiques sur lesquels les Berlusconi espèrent pouvoir compter.
Une "italianité" que, selon la presse italienne, la banque Intesa Sanpaolo serait elle aussi prête à défendre, en prenant le contrôle de Generali, alors qu'on dit l'assureur convoité par le français Axa.
Intesa a confirmé mardi soir étudié d'éventuelles synergies avec Generali, et la presse croit de plus en plus à l'hypothèse d'une offre publique d'échange lancée par la banque sur l'assureur.
"Generali a dans son porte-feuille quelque 70 milliards d'euros de titres de l'Etat italien" et a donc "un rôle stratégique pour tout le pays", ce qui pourrait être une des raisons expliquant l'intérêt d'Intesa, déclare à l'AFP Marco Giorgino, professeur à l'école Polytechnique de Milan.
Il souligne néanmoins "penser et espérer que la défense de l'italianité n'est la seule cause: aujourd'hui en Europe, on s'oriente vers une consolidation du système financier, avec la constitution de grands acteurs, qui font de la banque, de l'assurance..." et l'opération peut avoir un vrai "sens stratégique" pour Intesa.
. Pour plus d'informations, n'hésitez-pas à lire ou à relire le dossier 09 novembre 2016, intitulé : L'Italie, un partenaire incontournable.